Par La Rédaction | lementor.net
La démocratie, avant d’être une architecture institutionnelle ou un cadre juridique, est d’abord une idée, un souffle, un pacte social fondé sur un principe simple mais fondamental : le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Cette définition que l’on doit à Abraham Lincoln ne repose pas sur un nombre de mandats, encore moins sur un article de loi, mais sur la capacité d’un peuple à choisir ses dirigeants, aussi souvent ou aussi peu souvent qu’il le souhaite. Or, en Afrique, un amalgame dangereux a fini par s’installer dans le débat public : celui qui consiste à confondre démocratie et limitation du nombre de mandats. Comme si, à elle seule, cette restriction suffisait à garantir l’esprit démocratique. Comme si la loi, dans toute sa rigidité, pouvait trancher un débat éminemment politique, social, culturel, et même philosophique.
La démocratie n’est pas d’abord affaire de droit ; elle est affaire de volonté collective. Elle n’est pas née dans les textes, mais dans les places publiques, dans les luttes populaires, dans la volonté partagée de vivre ensemble sous des règles acceptées par tous. Pourtant, les sociétés modernes, notamment en Occident, ont progressivement voulu traduire cette volonté en lois, pensant fixer dans le marbre juridique ce qui relève en réalité du vivant, du mouvant, de l’inspiration des peuples. C’est là une erreur d’interprétation qui, hélas, a été importée en Afrique sans discernement.
Limiter les mandats, c’est contraindre le choix du peuple. C’est lui dire : même si vous souhaitez reconduire un dirigeant, vous ne le pouvez pas. Ce n’est donc pas un garde-fou démocratique, mais bien une barrière imposée à la souveraineté populaire. Car la vérité, aussi dérangeante soit-elle, est que l’on peut être acclamé après quatre mandats comme être rejeté après un seul. Et cela, seul le peuple peut en décider, dans la liberté de son suffrage et la transparence des urnes. Nul besoin d’un article de la Constitution pour dicter ce que le peuple peut ou ne peut pas vouloir. Ce n’est pas un bout de papier qui fonde la légitimité, c’est le consentement libre et renouvelé des citoyens.
L’histoire même de la limitation des mandats démontre sa nature profondément contextuelle. Ce n’est ni une règle sacrée, ni un principe universel. Elle est née dans le contexte américain, d’un accord tacite après les mandats de Franklin D. Roosevelt, réélu quatre fois entre 1932 et 1944, en pleine crise économique puis en pleine guerre mondiale. Pour prévenir les risques de dérive autoritaire et permettre à d’autres figures de la nation de se projeter vers le pouvoir, une norme a été instaurée – non pas au nom d’une vérité démocratique absolue, mais en fonction d’une situation particulière. Cette norme ne fut d’ailleurs constitutionnalisée qu’en 1951, avec le 22e amendement. En faire aujourd’hui une règle intangible de la démocratie, applicable uniformément à tous les pays, c’est méconnaître son origine et trahir sa logique.
Mais le plus grand mal réside peut-être ailleurs. Il est dans cette tendance généralisée à plaquer sur l’Afrique des modèles sans discernement, à copier des mécanismes sans les adapter, à confondre le jeu politique – qui varie selon les histoires, les peuples et les cultures – et le jeu démocratique – qui est d’abord un cadre ouvert où le peuple arbitre librement. Or, nos contemporains, en Afrique, refusent souvent de distinguer ces deux dynamiques. Ils y voient un tout indissociable, une orthodoxie intouchable. C’est là une source de confusion majeure.
Ce qu’il nous faut, ce ne sont pas des règles figées, calquées mécaniquement sur des démocraties anciennes, mais des processus électoraux solides, crédibles, équitables. Ce qu’il nous faut, ce ne sont pas des limitations imposées d’en haut, mais des choix assumés d’en bas. Car la démocratie, la vraie, n’est ni occidentale, ni orientale, ni tropicale : elle est là où le peuple a confiance dans le processus et accepte pacifiquement son verdict. Le reste n’est que gesticulation politicienne, travestie en principes de gouvernance.
C’est à cette lucidité que l’Afrique est aujourd’hui appelée. À cette capacité de penser ses institutions à partir de ses réalités, de forger ses outils à partir de ses aspirations, de bâtir sa démocratie à partir de sa propre voix. Le nombre de mandats n’est pas une norme démocratique. C’est une option politique. Ne pas le comprendre, c’est condamner nos nations à vivre dans l’ombre d’une démocratie importée, plutôt que dans la lumière d’une souveraineté assumée.





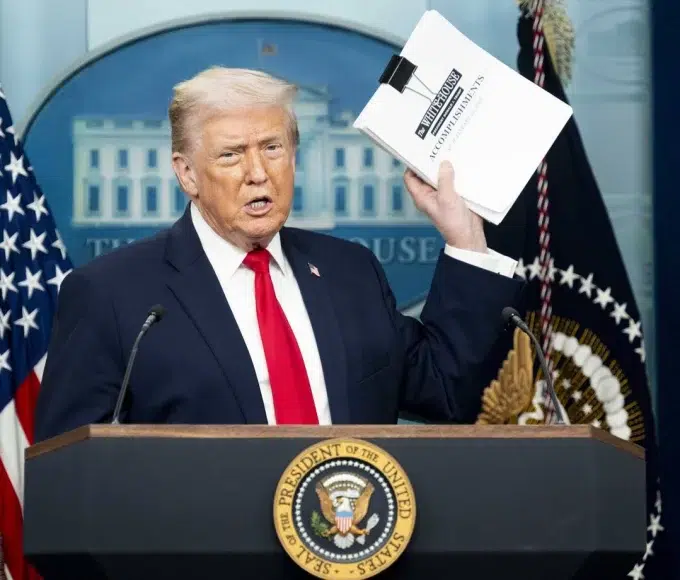











Leave a comment