Depuis leur rupture avec certains partenaires traditionnels, notamment la France et certaines institutions occidentales, les pays de la Zone AES multiplient les ouvertures diplomatiques et économiques vers d’autres puissances. Cette réorientation stratégique s’inscrit dans une volonté d’indépendance, mais aussi dans une logique de diversification des alliances. Trois pays émergent comme partenaires privilégiés : la Russie, la Turquie et la Chine.
La Russie, alliée sécuritaire et politique
Le partenariat avec la Russie s’est intensifié à partir de 2021, en particulier au Mali et en Centrafrique, avant de s’étendre au Burkina Faso et au Niger. Présentée comme un allié sans condition politique, la Russie intervient principalement dans le domaine militaire, par le biais de la société paramilitaire Wagner, devenue officiellement Africa Corps depuis sa réorganisation. Des formateurs russes, des équipements militaires, mais aussi des conseillers stratégiques ont été déployés dans plusieurs capitales sahéliennes. Ce partenariat s’appuie sur un discours de solidarité souverainiste et sur une hostilité partagée vis-à-vis de l’Occident, tout en répondant à des besoins de sécurité immédiats.
La Turquie, partenaire polyvalent et discret
Moins visible que la Russie, la Turquie joue une carte économique et diplomatique plus large. Présente depuis plusieurs années en Afrique de l’Ouest, elle développe des projets d’infrastructures, des partenariats éducatifs, des investissements dans la santé et le commerce. Les entreprises turques remportent des marchés de construction d’aéroports, de routes ou de centrales électriques, tout en tissant des liens institutionnels avec les gouvernements. Le modèle turc séduit par sa souplesse, son absence d’agenda politique intrusif et sa capacité d’exécution rapide. Ankara cherche à se positionner comme une puissance émergente fiable dans un espace en recomposition.
La Chine, acteur économique incontournable
La Chine reste l’un des plus grands partenaires commerciaux du continent africain et les pays de la Zone AES ne font pas exception. Pékin investit dans les mines, l’énergie, les routes et les télécommunications. Elle propose également des prêts à faible taux, des projets clés en main et une coopération technique étendue. Les gouvernements sahéliens voient dans cette relation un levier de développement rapide, sans les conditionnalités démocratiques souvent exigées par les institutions occidentales. Toutefois, les modalités de remboursement, la transparence des contrats et la qualité des réalisations suscitent parfois des interrogations dans la société civile.
Vers un rééquilibrage diplomatique
Cette diversification des partenaires traduit un changement profond dans la manière dont les États du Sahel conçoivent leur diplomatie. Il ne s’agit pas seulement de rompre avec l’ancienne puissance coloniale, mais de construire une diplomatie plus équilibrée, orientée vers des intérêts mutuels et des partenariats stratégiques adaptés à leurs priorités. Les pays de l’AES affirment désormais qu’ils veulent coopérer avec tous ceux qui respectent leur souveraineté, qu’ils viennent de Moscou, d’Istanbul ou de Pékin.
Entre indépendance proclamée et nouvelles dépendances
Si cette stratégie permet une certaine autonomie à court terme, elle comporte également des risques. En s’éloignant des institutions régionales et multilatérales classiques, les pays de la Zone AES s’exposent à de nouvelles formes de dépendance, notamment financière ou technologique. La vigilance sur les termes des accords signés, leur impact social et environnemental, ainsi que leur transparence, sera déterminante pour que ces partenariats soient réellement bénéfiques à long terme.





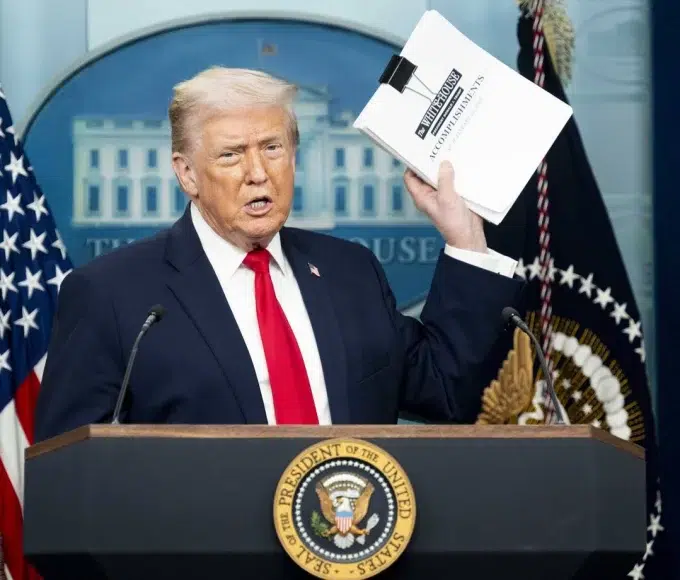










Leave a comment