Par La Rédaction | lementor.net
La démocratie ne se résume pas à un bulletin déposé dans l’urne ni à une alternance de figures au sommet de l’État. Elle prend racine bien plus en amont au cœur des partis politiques. Car c’est dans la façon dont ceux-ci s’organisent, débattent et choisissent leurs représentants que se joue la véritable santé démocratique d’une nation. Un pays ne peut prétendre à la maturité politique si ses formations internes fonctionnent encore sur la base du culte du chef, du clientélisme ou du silence imposé.
Les partis, premiers laboratoires de la démocratie
Le fonctionnement interne des partis est le premier indicateur de la qualité du régime démocratique. Là où les structures partisanes favorisent la consultation, la contradiction et la transparence, les institutions publiques tendent à suivre le même modèle. À l’inverse, lorsqu’un parti impose ses candidats sans débat, bâillonne les voix dissidentes et transforme ses congrès en cérémonies d’allégeance, la démocratie devient une façade.
Le mode de désignation des candidats est à cet égard révélateur. Les primaires ouvertes ou fermées offrent un espace d’expression à la base militante et permettent au candidat choisi de bénéficier d’une légitimité populaire incontestable. Mais elles exigent rigueur, neutralité et un fichier fiable. La désignation par le bureau politique, quant à elle, assure une cohérence stratégique, mais elle doit être entourée de règles précises pour éviter les soupçons d’arbitraire.
Entre les deux extrêmes, certains partis choisissent l’acclamation, souvent lors de congrès nationaux. Ce geste d’unité n’a de valeur que s’il émane d’un consensus sincère et non d’une unanimité imposée. Dans d’autres cas, l’arbitrage d’un leader ou d’un comité de sages peut trancher entre plusieurs prétendants, à condition que cet arbitre soit neutre et guidé par l’intérêt collectif.
Une chose est certaine : il ne peut y avoir de démocratie nationale sans démocratie interne. Les statuts des partis doivent garantir la transparence de ces procédures, définir les conditions de candidature et prévoir des voies de recours. La base doit savoir comment se prend la décision et sur quels critères. C’est le respect de ces règles, plus que les discours, qui fait d’un parti une véritable école de citoyenneté.
L’indépendance, entre liberté et déloyauté
Un autre défi, plus discret mais tout aussi crucial, concerne les candidatures indépendantes. Dans une démocratie solide, la possibilité de se présenter hors d’un parti est un droit fondamental. Mais ce droit ne peut servir de prétexte aux frustrations internes ou à la revanche personnelle.
Se déclarer candidat indépendant tout en restant membre d’un parti est une contradiction morale et politique. Celui qui s’oppose au choix collectif de sa formation devrait d’abord s’en détacher avant de se lancer seul. Autrement, il trahit la logique même de la démocratie interne et alimente la confusion dans l’esprit des électeurs.
Plus problématique encore est le phénomène des élus indépendants qui, une fois victorieux, rejoignent le parti qu’ils avaient combattu. Cette pratique brouille la volonté populaire : l’électeur vote pour une personne libre de toute étiquette, mais voit son choix récupéré par une formation qu’il n’a pas mandatée. La démocratie se vide alors de sa substance. Dans un État cohérent, un tel élu ne devrait pouvoir intégrer un parti qu’à la fin de son mandat ou après une nouvelle élection. C’est une mesure de respect du vote et de la confiance du peuple.
Discipline et cohérence, piliers de la liberté
La liberté démocratique n’exclut pas la discipline ; elle en dépend. Dans les circonscriptions où un élu en exercice reste fidèle à son parti et à sa base, il n’est ni logique ni loyal de le défier lors de primaires internes uniquement par ambition personnelle. La compétition interne n’a de sens que lorsqu’un mandat est trahi, usé ou contesté pour de bonnes raisons. La démocratie n’est pas une foire d’ego, mais une organisation du désaccord.
Les partis doivent donc concilier ouverture et rigueur : ouverture pour accueillir les idées nouvelles, rigueur pour préserver la cohérence collective. Accepter tout et son contraire au nom du pluralisme revient à dissoudre l’autorité politique. Refuser tout débat au nom de la discipline revient à étouffer la démocratie. Le juste équilibre se trouve dans la clarté des règles et la constance des principes.
Pour une démocratie de responsabilité
En définitive, la démocratie n’est ni un slogan ni une posture. C’est un système de responsabilité partagée : celle des dirigeants, des militants et des institutions. Un parti qui pratique la démocratie en son sein prépare déjà un exercice du pouvoir plus transparent et plus respectueux. À l’inverse, un parti autoritaire engendre un État fermé et vertical.
Si la Côte d’Ivoire veut consolider ses institutions et renforcer la confiance des citoyens, elle doit exiger la démocratie d’abord là où elle prend naissance : dans les partis politiques. Car c’est de la qualité du débat interne que naîtra, demain, la maturité de la gouvernance nationale.





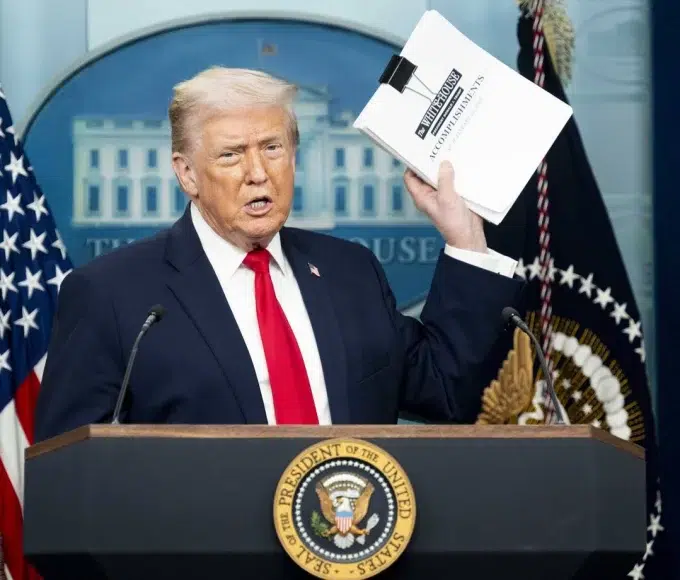
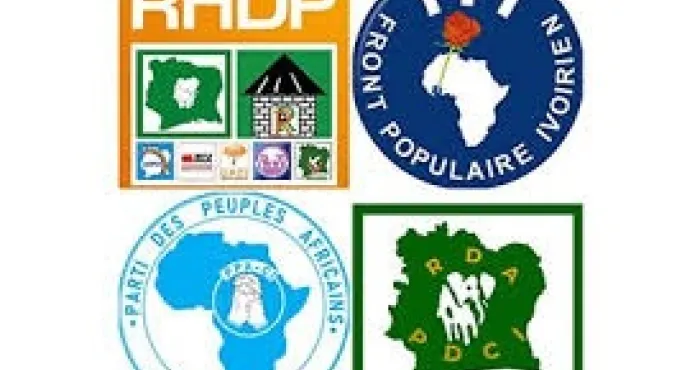










Leave a comment