Par Bakary Cissé | lementor.net
En Afrique de l’Ouest, le populisme s’impose comme une réponse séduisante aux frustrations populaires face à la pauvreté persistante, à la corruption endémique et à l’influence étrangère. Des figures charismatiques comme Ousmane Sonko au Sénégal, ou les juntes militaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, captent les foules en dénonçant les « élites vendues » et en promettant une souveraineté radicale. Mais derrière la ferveur des discours, l’illusion se dissipe : le populisme, dénué de vision claire, engendre l’instabilité plus qu’il ne construit la prospérité.
Le mirage sénégalais
L’ascension d’Ousmane Sonko, élu en 2024, illustre bien cette dynamique. Sa campagne fut marquée par une rhétorique accusatrice visant les « prédateurs étrangers » accusés d’avoir « vendu la mer, le pétrole, même l’air ». Cette approche, rappelant les dérives ethnicistes ivoiriennes du passé, a séduit une partie de l’électorat mais sans véritable projet concret. Depuis son arrivée au pouvoir, le Sénégal fait face à une dette publique écrasante (119 % du PIB), à un déficit budgétaire de 14 % et à des tensions politiques internes.
Certes, le pays bénéficie encore d’une forte croissance (8,8 % projetée en 2025), portée par l’augmentation spectaculaire des investissements directs étrangers (IDE), passés de 1,06 milliard de dollars en 2019 à 2,64 milliards en 2023. Mais ce potentiel est fragilisé par une orientation politique qui privilégie l’isolement au détriment de la coopération, menaçant de freiner les flux financiers et de renforcer l’insécurité alimentaire.
Le chaos sahélien
Dans le Sahel, le populisme s’est traduit par des coups d’État militaires présentés comme une libération face à l’« impérialisme occidental ». Au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, les putschistes ont surfé sur une vague de rejet de la France, gagnant dans un premier temps une popularité certaine. Mais la réalité économique est implacable : croissance ralentie, sanctions de la CEDEAO, isolement financier et aggravation de la faim.
La création en janvier 2025 de l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant ces trois pays après leur départ de la CEDEAO, concerne 16 % de la population ouest-africaine mais menace de perturber les chaînes d’approvisionnement régionales, faisant grimper les prix alimentaires. Parallèlement, l’insécurité djihadiste ne faiblit pas : plus de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde sont concentrés dans cette zone. Loin d’apporter des solutions structurelles, le populisme y a renforcé l’instabilité.
Le pragmatisme ivoirien
À l’opposé, la Côte d’Ivoire offre un contre-exemple pragmatique. Depuis l’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, le pays a connu une transformation économique profonde. Le PIB est passé de 35 milliards de dollars en 2011 à 86,5 milliards en 2024, avec une croissance moyenne de 8,2 % sur la période 2012-2019.
La Côte d’Ivoire attire aujourd’hui près de 3,8 milliards de dollars d’IDE par an, se classant au troisième rang continental. Leader mondial du cacao (2 millions de tonnes annuelles) et acteur majeur dans la noix de cajou, l’hévéa et le coton, le pays investit dans la transformation locale, bâtissant une industrie agroalimentaire compétitive. Sur le plan sécuritaire, Ouattara a modernisé l’armée et renforcé les alliances internationales, faisant du pays un rempart contre l’instabilité régionale.
Ces résultats économiques et sécuritaires contrastent fortement avec les trajectoires chaotiques de ses voisins. Ils ne gomment pas pour autant les critiques : la réforme constitutionnelle de 2016, qui lui permet de briguer un nouveau mandat en 2025, suscite des inquiétudes sur la vitalité démocratique. Mais les avancées restent tangibles : réserves de change solides, inflation maîtrisée, investissements soutenus dans l’éducation et la santé.
Entre slogans et souveraineté réelle
L’expérience récente de l’Afrique de l’Ouest révèle les limites du populisme. Il séduit par ses slogans, mobilise par ses promesses, mais échoue dans la gouvernance. Il transforme des nations en États quémandeurs, minés par l’isolement et la dépendance.
À l’inverse, la véritable souveraineté s’acquiert par le travail patient de construction d’infrastructures, de diversification économique, d’ouverture maîtrisée aux partenariats internationaux et de consolidation des institutions. Les peuples ouest-africains n’ont pas besoin de démagogues en quête de gloire personnelle, mais de dirigeants capables de bâtir des États producteurs, innovants et protecteurs.
La leçon est claire : le populisme promet la libération, mais livre le déclin. L’Afrique de l’Ouest doit tourner le dos au cirque des slogans et choisir la voie du pragmatisme, seule garante d’une souveraineté réelle et durable.



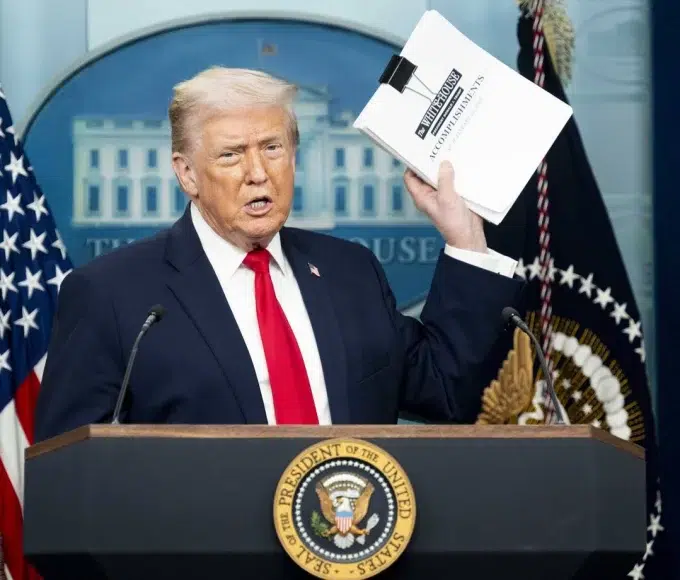













Leave a comment