Par La Rédaction
À trois mois de l’élection présidentielle, le bruit monte, les postures s’affichent, mais les idées, elles, peinent toujours à émerger. Dans les meetings comme dans les médias, la scène politique ivoirienne semble incapable de sortir du vieux schéma des fidélités ethno-régionales, des règlements de comptes personnels et des procès en légitimité. La campagne s’ouvre avec les mêmes acteurs, les mêmes logiques, les mêmes crispations. À croire que depuis trente ans, la politique ivoirienne tourne en boucle, sans jamais entrer dans le fond. Et pendant ce temps, les vrais enjeux, eux, restent au second plan. Où sont les débats sur l’école, sinistrée dans de nombreuses régions ? Où sont les propositions concrètes pour améliorer un système de santé encore largement inégalitaire et précaire ? Qui parle sérieusement de la justice, de l’accès à l’emploi des jeunes, de la revalorisation de l’agriculture vivrière, ou encore de l’avenir numérique du pays ?
Trop souvent, la politique nationale ne se pense pas comme un service public à rendre, mais comme un territoire à conquérir. L’arène est dominée par des figures perçues comme des totems, et non comme des porteurs de vision. Le débat se joue davantage sur les personnes que sur les idées. Le contenu est sacrifié au profit de l’image, les projets de société effacés au profit des querelles de clans. Cette dérive est alimentée par plusieurs facteurs : une culture politique peu portée sur la pédagogie, une société civile encore trop timide ou trop courtisée, des médias obnubilés par le sensationnel, et une jeunesse à la fois politisée et désabusée, piégée entre TikTok et résignation. Ce n’est pas la compétence qui fait aujourd’hui le poids d’un candidat, mais la capacité à mobiliser un réseau, à séduire des chefs locaux, à garantir une loyauté ethnique. Dans un tel contexte, rêver d’un débat d’idées semble presque naïf. Et pourtant, ce rêve est plus que jamais nécessaire.
Car la Côte d’Ivoire de 2025 n’est plus celle des années 90. Le pays a changé. Une nouvelle génération émerge, plus instruite, plus connectée, plus exigeante. Une génération qui ne veut pas seulement voter pour une figure tutélaire, mais pour un avenir. Ces électeurs en devenir attendent qu’on leur parle d’avenir énergétique, de transformation des universités, de protection de l’environnement, de transition agricole, de justice sociale. Ils veulent savoir ce qu’on compte faire concrètement pour réduire la fracture entre Abidjan et les zones rurales, entre les élites et les citoyens ordinaires, entre les mots de campagne et les actes de gouvernance.
Ce manque d’idées ne traduit pas une pénurie d’intelligence dans le pays. Au contraire. La Côte d’Ivoire regorge de chercheurs, de jeunes entrepreneurs, d’enseignants, de médecins, d’économistes, d’activistes, qui portent des propositions solides. Mais leur parole reste marginalisée, reléguée aux tribunes spécialisées ou aux réseaux sociaux. L’espace politique ne leur est pas ouvert, ou alors seulement à la condition de s’aligner. Il y a là un immense gâchis démocratique.
La présidentielle de 2025 devrait être l’occasion d’un tournant. Non pas seulement une alternance de personnes, mais une rupture de méthode. Un retour au fond. À la clarté programmatique. À la rigueur dans les diagnostics et les solutions. Il est encore temps de remettre les idées au centre. Mais cela ne se fera pas sans une pression populaire. Il faut que les citoyens exigent des débats, que les journalistes les imposent, que les partis les organisent. Il faut aussi que les candidats aient le courage d’affronter la complexité des problèmes et de défendre des choix, y compris impopulaires. La politique n’est pas un concours de promesses faciles, mais un contrat de confiance fondé sur la responsabilité.
Si cette dynamique ne s’enclenche pas maintenant, nous resterons prisonniers d’un théâtre sans texte, où l’on vote plus par réflexe que par conviction, plus par loyauté que par lucidité. Et une démocratie sans idées finit tôt ou tard par se retourner contre elle-même. Il est encore temps de rêver. Mais il faudrait surtout commencer à penser.





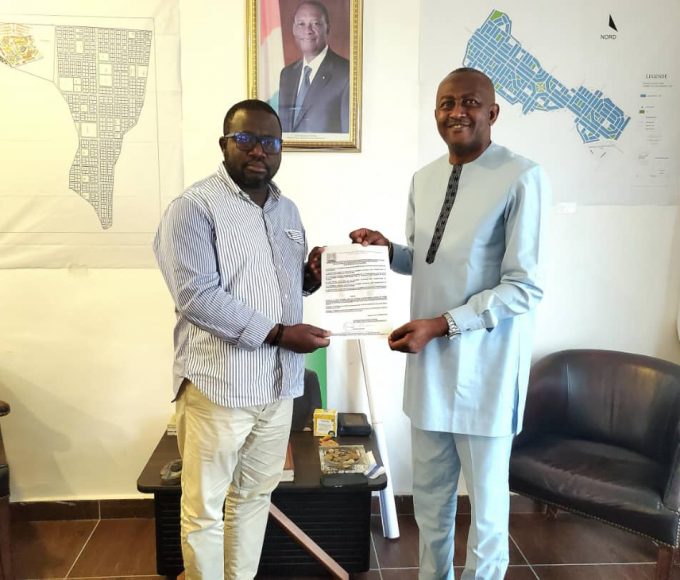

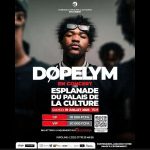








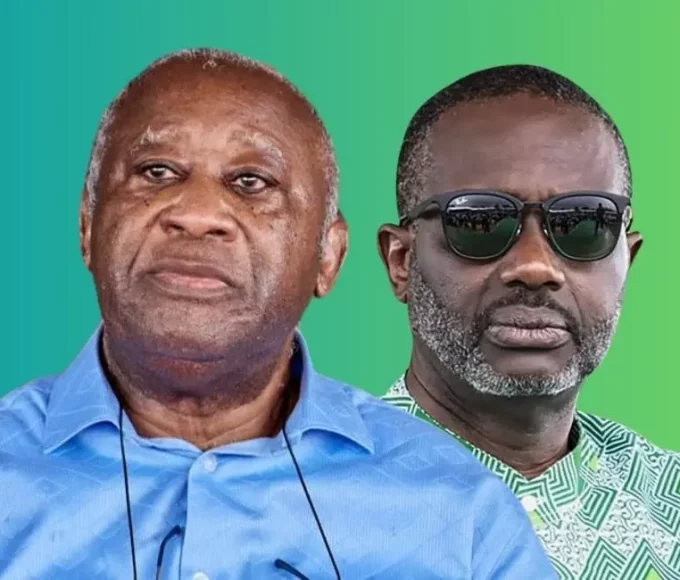
Leave a comment