Depuis leur formation, les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger affirment gouverner avec le soutien de leur peuple. Leurs discours insistent sur un lien direct avec les citoyens, souvent opposés à l’élite politique précédente et favorables à un changement de cap radical. Mais que pense réellement la population dans ces trois pays ? S’agit-il d’un soutien librement exprimé ou d’un consentement obtenu dans un climat de tension et de répression ?
Dans les premiers mois ayant suivi les prises de pouvoir, les scènes de liesse populaire à Bamako, Ouagadougou et Niamey ont donné l’image d’une adhésion massive. Les discours anti-impérialistes, les ruptures avec certaines puissances étrangères, et la volonté affichée de reconquérir la souveraineté ont touché une large partie de la jeunesse, frustrée par des années de précarité, de chômage et d’insécurité. Les réseaux sociaux sont devenus des caisses de résonance pour cette ferveur, entre patriotisme assumé et rejet de l’ordre ancien.
Cependant, au fil des mois, la situation s’est complexifiée. Les difficultés économiques, les retards dans les calendriers de transition, la persistance des attaques terroristes et les restrictions de libertés ont contribué à éroder l’enthousiasme initial. Les voix critiques, bien que minoritaires dans l’espace public officiel, dénoncent un climat de peur, la fermeture des espaces démocratiques et l’absence de mécanismes de redevabilité. Dans plusieurs cas, des journalistes, des militants ou des opposants ont été interpellés ou réduits au silence. La frontière entre soutien sincère et absence de contestation devient alors floue.
Il est difficile de mesurer objectivement l’opinion publique dans des contextes où les enquêtes indépendantes sont rares et les institutions de sondage peu actives. Les manifestations pro-régime sont largement relayées, tandis que les formes de dissidence s’expriment surtout à travers des canaux discrets ou dans la diaspora. Pourtant, certaines préoccupations sont largement partagées : l’amélioration du quotidien, la lutte contre la corruption, la sécurité des zones rurales, et le respect des promesses de refondation.
Dans les zones les plus exposées à la violence armée, le soutien aux autorités militaires reste fort, car elles sont perçues comme les seules capables de ramener l’ordre. Dans les capitales, en revanche, une partie de l’élite urbaine commence à exprimer des doutes sur la gouvernance autoritaire et le manque de perspectives économiques. Le silence apparent de certaines catégories sociales ne signifie pas nécessairement l’adhésion.
L’opinion publique dans les pays de l’AES ne peut donc pas être réduite à un bloc uniforme. Elle est mouvante, traversée de contradictions, influencée par les médias, les pressions sécuritaires, mais aussi par un réel désir de changement. Le soutien dont bénéficient les autorités militaires repose sur un contrat fragile : celui de protéger, de redonner espoir et de construire un avenir. Si ces attentes ne sont pas comblées, ce soutien pourrait se transformer en déception.





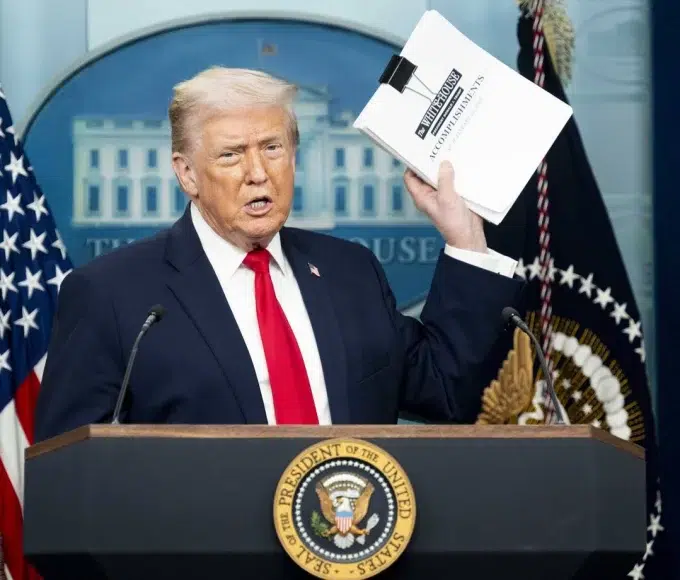











Leave a comment