Depuis l’instauration des régimes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la place réservée à l’opposition politique est devenue un sujet de préoccupation aussi bien pour les défenseurs des droits civiques que pour les institutions internationales. Si les autorités de la Zone AES affirment leur volonté de refonder les États sur de nouvelles bases, cette transition s’accompagne souvent d’un rétrécissement de l’espace politique, limitant la capacité des partis d’opposition à s’exprimer, à organiser des activités ou à jouer leur rôle de contre-pouvoir.
Dans les trois pays, les pouvoirs de transition justifient les restrictions imposées aux opposants par le contexte sécuritaire. Selon les dirigeants, l’unité nationale face à la menace terroriste nécessite la suspension temporaire des antagonismes politiques. Ce discours s’appuie sur le rejet populaire des anciennes élites accusées de compromission, d’inefficacité ou de corruption. Dans ce climat, toute voix critique est vite assimilée à une tentative de déstabilisation ou à une manipulation extérieure.
Les partis d’opposition traditionnels peinent à se faire entendre. Certains leaders ont été mis en résidence surveillée, d’autres empêchés de voyager, et plusieurs formations politiques ont vu leurs activités suspendues ou leurs sièges fermés. Les réunions publiques sont encadrées, voire interdites, au nom de l’ordre public. L’accès aux médias d’État est très limité pour les courants opposés, et les médias privés critiques font face à des pressions croissantes, parfois à des suspensions administratives.
Dans ce contexte, l’expression de l’opposition se replie sur les réseaux sociaux ou à travers la diaspora. Des militants en exil tentent de maintenir le débat démocratique, d’alerter l’opinion internationale et d’organiser des mouvements alternatifs. Mais leur impact sur la scène politique locale reste limité, en raison de la coupure entre les espaces virtuels et la réalité quotidienne sur le terrain.
Certains observateurs notent toutefois une évolution. Dans le cadre des processus de rédaction de nouvelles constitutions, des appels à la consultation élargie ont été lancés, avec la promesse d’associer divers acteurs, y compris les partis historiques. Mais dans les faits, cette participation reste souvent symbolique, encadrée et sans réel pouvoir de décision. L’inclusivité est invoquée, mais rarement appliquée de manière substantielle.
L’absence d’opposition active dans la vie politique des pays de la Zone AES soulève une question essentielle pour l’avenir des transitions : quelle forme de pluralisme politique est envisagée une fois la période militaire achevée ? Le risque est que le modèle en construction, fondé sur la centralisation du pouvoir et la marginalisation des contre-pouvoirs, s’installe dans la durée et compromette le retour à une vie politique équilibrée.
L’espace politique dans la Zone AES reste donc étroit, balisé et sous contrôle. La reconstruction de la confiance entre les institutions et les forces politiques adverses nécessitera un cadre clair, des garanties constitutionnelles et une volonté politique forte. À défaut, la promesse de refondation pourrait se transformer en verrouillage durable du débat démocratique.





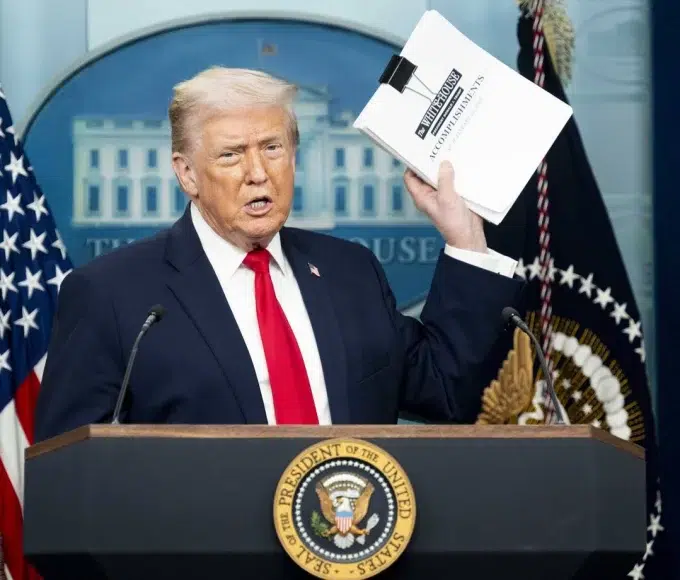











Leave a comment