Par Bakary Cissé, en collaboration avec la Rédaction
L’histoire retiendra peut-être ce moment comme celui d’une rupture courageuse. Ou alors comme une fâcheuse aventure économique au goût amer. Ce qui est sûr, c’est que les États de l’AES – Mali, Burkina Faso, Niger – ont décidé de tourner le dos à l’UEMOA et à sa politique monétaire commune, dans un élan de reconquête souverainiste qui fait davantage penser à une déclaration d’indépendance émotionnelle qu’à une stratégie économique réfléchie. Le geste est fort, symboliquement parlant. Mais derrière la posture martiale, la réalité frappe déjà à la porte : l’inflation galope, les devises fondent comme neige au soleil, les étals se vident, et les caisses publiques sont à bout de souffle.
On entend ici et là dénoncer la BCEAO comme le dernier bastion d’un colonialisme monétaire à abattre. Pourtant, nombreux sont ceux qui, dans les couloirs du pouvoir sahélien, savent qu’en l’absence d’un prêteur en dernier ressort crédible, la machine économique vacille. Qui refinancera les banques commerciales en cas de crise de liquidité ? Qui offrira des garanties pour l’importation du riz, du carburant, ou des médicaments ? Croire que Moscou ou Pékin viendra à la rescousse, chéquier en main, relève du vœu pieux. La Russie est elle-même engluée dans une guerre coûteuse et des sanctions asphyxiantes. Quant à la Chine, elle n’avance que sur gages solides et intérêts bien calculés. Le patriotisme monétaire, aussi noble soit-il, ne paie pas les factures à l’international.
Créer une monnaie est un acte de souveraineté. Mais c’est aussi une opération d’une extrême technicité, qui suppose rigueur, discipline budgétaire, cohérence économique, et surtout… confiance. Le Mali en a déjà fait l’amère expérience dans les années 60 avec le franc malien, rapidement abandonné après une dépréciation catastrophique. Cette leçon semble oubliée. Aujourd’hui, les réserves de change des pays de l’AES couvrent à peine quelques mois d’importations, les exportations restent concentrées sur l’or, le bétail et quelques produits agricoles, et les investisseurs étrangers regardent la région avec prudence, sinon inquiétude. Dans un tel contexte, lancer une monnaie indépendante revient à sauter dans le vide sans parachute, en priant pour que la géopolitique fasse office de filet.
Car la vérité est là : sans intégration régionale, sans marché commun, sans une politique économique concertée, la monnaie ne vaut que ce que les autres veulent bien lui reconnaître. La sortie de l’UEMOA, bien plus qu’un divorce administratif, coupe l’AES d’un espace de libre circulation, d’un système bancaire intégré, de mécanismes de solidarité budgétaire et de stabilité des prix. C’est tout un cadre de discipline macroéconomique qui s’effondre. Et avec lui, la possibilité pour les populations sahéliennes d’acheter, d’épargner, d’échanger en confiance. La souveraineté n’est plus un projet : elle devient une austérité.
Les dirigeants de l’AES assurent que de « nouveaux partenaires » sont en ligne. Mais qui, sérieusement, viendra arrimer une monnaie sahélienne naissante à sa devise ? Quelle banque centrale acceptera de garantir des transferts, des réserves, ou des lignes de crédit en devise ? Les discussions avec Moscou et Ankara, parfois évoquées, relèvent davantage du narratif géopolitique que d’un plan de sauvetage économique. Et pendant ce temps, dans les rues de Bamako, Niamey ou Ouagadougou, les files d’attente pour l’essence, le sucre ou les produits de première nécessité s’allongent, pendant que les prix s’envolent et que les petites entreprises s’étouffent.
En choisissant la rupture, l’AES a peut-être gagné une bataille symbolique. Mais elle risque de perdre la guerre économique. Car la souveraineté monétaire, sans la crédibilité qui l’accompagne, devient vite une illusion coûteuse. Et dans ce jeu dangereux, ce sont toujours les plus vulnérables qui paient l’addition. On peut bien blâmer « l’Occident », « la Françafrique », ou la tutelle d’hier, mais à l’heure des bilans, les peuples n’écoutent plus les discours : ils regardent le prix du pain, la disponibilité des soins, la stabilité de leur emploi.
La souveraineté n’est pas une incantation. Elle se construit, patiemment, avec des institutions solides, une gouvernance prévisible, et une base productive capable de soutenir une monnaie nationale. À défaut, elle se transforme en fardeau que ni les tambours révolutionnaires ni les anathèmes géopolitiques ne pourront alléger. Quitter l’UEMOA n’est pas une faute en soi. Mais le faire sans plan, sans cap, et sans partenaires solides relève de l’improvisation. Et dans l’improvisation monétaire, l’histoire ne pardonne pas.





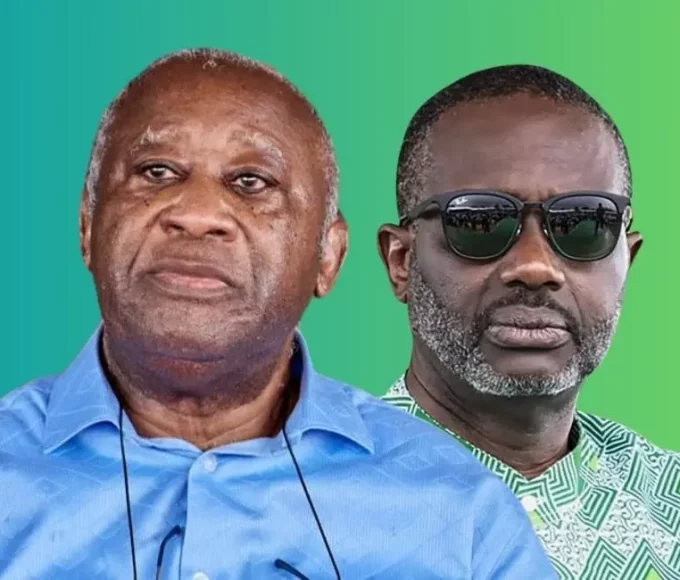











Leave a comment