Jean Pierre Assa | lementor.net
Dans une Côte d’Ivoire où l’opinion publique reste marquée par les traumatismes de la violence politique, les déclarations publiques ne sont jamais anodines. Celles du Front Populaire Ivoirien (FPI), à travers son Secrétaire Général Barthélemy Ire Gnépa, sur les événements de Yopougon et les aveux télévisés diffusés par la RTI, prennent un relief particulier. En dénonçant ce qu’il qualifie de coercition sur le prévenu et en exigeant une enquête sérieuse et non précipitée, le FPI ne se contente pas de prendre la défense d’un individu ; il ouvre un front plus large, celui de la défense des principes d’un État de droit malmené.
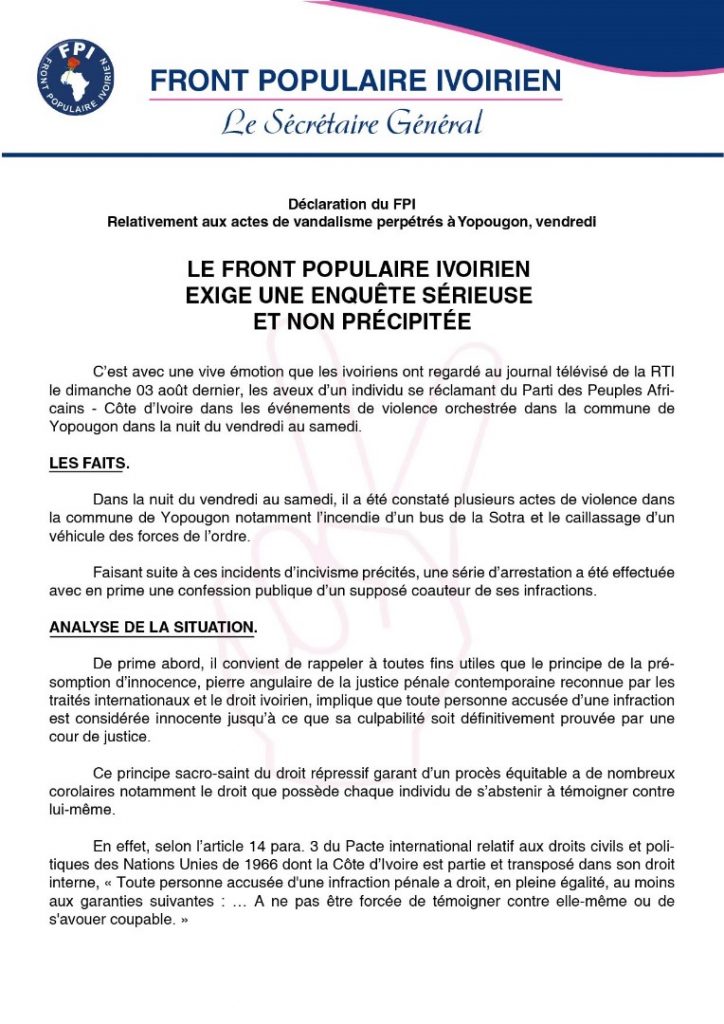
Au cœur de l’affaire : des actes de violence survenus à Yopougon, dont l’incendie d’un bus de la Sotra et le caillassage d’un véhicule de police. Dans la foulée, un individu se réclamant d’un parti d’opposition est arrêté et ses aveux, spectaculairement présentés à la télévision nationale, deviennent l’élément central de communication des autorités. Or, selon le FPI, ces aveux n’ont pas été obtenus dans le cadre d’un procès équitable mais sous une forme de pression psychologique, voire physique, sans la présence d’un avocat. Ce point précis, s’il est avéré, pose un problème de légalité et de crédibilité des procédures judiciaires, et au-delà, de la manière dont le pouvoir instrumentalise la justice dans l’espace public.
Le recours à des aveux télévisés comme outil de communication gouvernementale n’est pas inédit, mais il interroge profondément sur les garanties des droits humains dans le contexte actuel. Le FPI s’appuie d’ailleurs sur le droit international, notamment l’article 14 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, pour rappeler que nul ne peut être forcé à témoigner contre lui-même ou à avouer sa culpabilité. En clair, la justice ne peut être spectacle, et encore moins outil d’intimidation politique. Ce rappel vient réinscrire le débat dans une dimension juridique et morale, loin des simples considérations partisanes.
Mais au-delà de l’analyse juridique, la déclaration du FPI revêt une portée politique stratégique. En dénonçant à la fois l’arbitraire des arrestations, les atteintes à la dignité humaine, et les aveux extorqués « dignes de l’époque moyenâgeuse », le parti cherche à repositionner le débat sur la gouvernance actuelle. Il ne s’agit pas seulement de contester une procédure, mais de remettre en cause un système, celui du RHDP, qu’il accuse de dérive autoritaire. Le FPI tend ainsi la main aux autres formations de l’opposition pour une unité d’action, appelant à s’affranchir d’un pouvoir qui, selon lui, se sert de l’appareil judiciaire comme d’un levier politique.
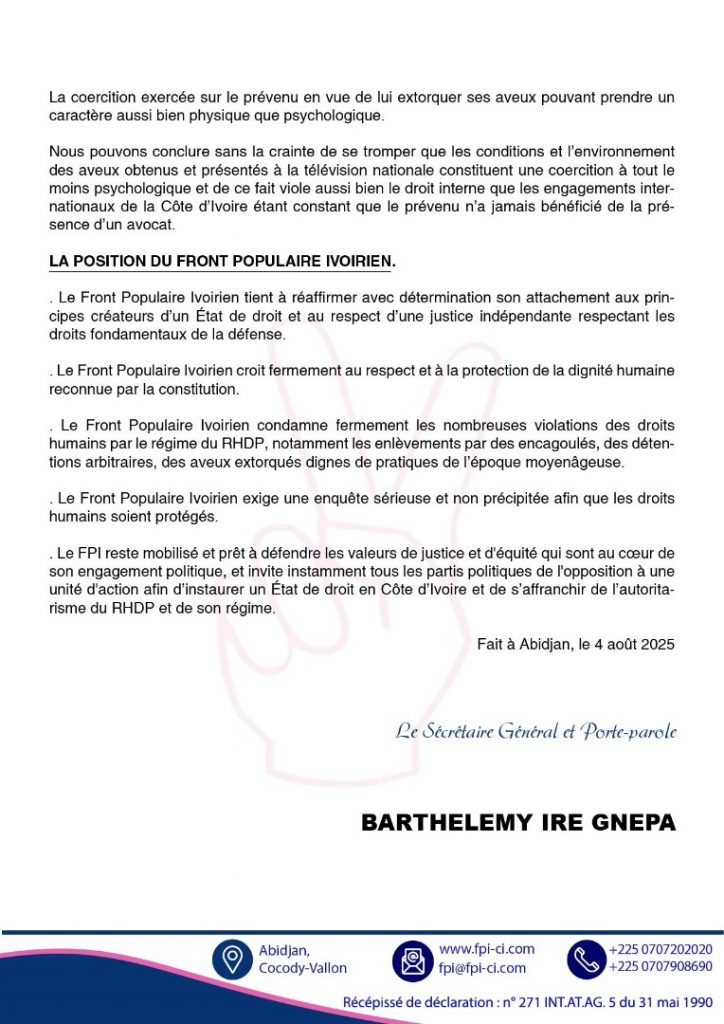
Ce type de déclaration révèle en creux un climat de méfiance généralisée où la justice, pourtant pilier fondamental de toute démocratie, peine à s’extraire des soupçons d’instrumentalisation. Elle met également en lumière l’épineuse question de la communication étatique en matière de sécurité intérieure : quand l’État choisit de médiatiser des aveux avant tout jugement, il envoie un message contraire au principe de présomption d’innocence. Cette attitude contribue à brouiller la frontière entre information, propagande et pression morale.
Dans ce contexte, la sortie du FPI ne peut être réduite à un simple positionnement partisan. Elle met le doigt sur un enjeu central : celui de la légitimité de la réponse étatique face aux actes d’incivisme. Dans une démocratie adulte, cette légitimité ne se construit pas sur des aveux filmés ou des arrestations expéditives, mais sur la solidité des procédures, la transparence judiciaire et le respect scrupuleux des droits. À défaut, chaque dérapage, aussi habilement mis en scène soit-il, finit par fragiliser l’édifice républicain dans son ensemble.

















Leave a comment