Par Bakary Cissé avec la Rédaction
Depuis le 29 janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement acté leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce départ, justifié par une volonté affichée de rupture avec une institution jugée « inféodée » à des logiques extérieures, sonne comme un acte d’affirmation politique. Mais au-delà du symbole souverainiste, une question brûlante se pose : le retrait de ces trois pays de la CEDEAO est-il économiquement tenable ?
Une rupture à haut risque financier
L’analyse des flux financiers entre la CEDEAO et les États membres révèle une réalité préoccupante : en sortant de l’organisation, l’Alliance des États du Sahel (AES) se coupe de l’un de ses partenaires financiers les plus fiables, la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC).
Les chiffres sont parlants. À ce jour, plus de 211 millions de dollars d’investissements sont engagés par la BIDC dans des projets structurants dans les trois pays : 48,09 millions au Burkina Faso (agriculture, mobilité universitaire, accès à l’eau), 50 millions au Mali (infrastructure électrique entre Sikasso et Bamako), et 113,52 millions au Niger (électrification rurale, eau potable, relogement autour du barrage de Kandadji).
Ces projets ne sont pas des « plus » budgétaires. Ils touchent à l’essentiel : énergie, eau, infrastructures, agriculture. Autrement dit, aux fondations mêmes du développement. La BIDC n’est pas qu’un guichet de fonds : elle incarne aussi une garantie de crédibilité face aux bailleurs internationaux, grâce à son expertise, sa gouvernance régionale, et ses conditions de prêt souvent plus souples que celles des institutions comme la Banque mondiale, la BAD ou le FMI.
Les projets en cours, garantis. Mais après ?
Juridiquement, la BIDC a tenu à rassurer : les projets en cours iront jusqu’à leur terme, grâce aux contrats signés. Mais une fois ces engagements honorés, plus rien n’obligera la banque à renouveler son soutien. La logique institutionnelle est implacable : hors de la CEDEAO, point d’accès aux nouvelles lignes de crédit, point d’éligibilité aux futurs programmes régionaux.
Les conséquences pourraient être dramatiques pour l’AES. Car au-delà des fonds directs, la BIDC joue un rôle d’effet levier : elle attire des cofinancements, crédibilise les dossiers d’investissement, facilite l’accès aux marchés, réduit le risque perçu. Ce rôle d’intermédiaire et de garant sera difficile à remplacer.
Dans un contexte marqué par la faiblesse des recettes fiscales, la vulnérabilité au changement climatique et l’enlisement sécuritaire, les marges de manœuvre budgétaires des pays de l’AES sont plus qu’étroites. L’autofinancement est illusoire. Et sur les marchés internationaux, ces États, souvent mal notés, empruntent à des taux élevés, quand ils y accèdent encore.
Une banque de substitution, mais à quel horizon ?
Face à cette réalité, l’AES a annoncé la création prochaine de sa propre banque d’investissement. Sur le papier, la démarche semble logique : construire un outil régional autonome. Mais dans les faits, le pari est périlleux.
Car créer une institution financière digne de ce nom ne se décrète pas. Il faut des années – parfois une décennie – pour bâtir une structure crédible, capitalisée, disposant de la confiance des bailleurs, des procédures robustes, d’une gouvernance stable et d’une expertise technique reconnue. D’ici là, qui financera les projets urgents ? Quelles ressources mobiliser dans des économies fragilisées ? Quels capitaux attirer sans l’appui d’une structure déjà implantée comme la BIDC ?
Le danger est double. Primo, que cette future banque reste une coquille vide, faute de moyens. Secundo, que les projets vitaux – électrification, adduction d’eau, santé, routes – soient suspendus ou annulés, faute de financements disponibles.
Souveraineté ou isolement ?
Le retrait de la CEDEAO est un acte souverain. Mais la souveraineté ne se mesure pas uniquement à la capacité de dire non. Elle se construit aussi sur la capacité à investir, à bâtir, à répondre aux attentes des populations. Et sur ce terrain-là, le départ de l’organisation régionale ressemble davantage à un saut dans l’inconnu.
Les discours martiaux ne suffiront pas à remplir les barrages, électrifier les villages ou désenclaver les zones rurales. La transition vers une architecture financière autonome est possible – mais elle demande du temps, de la stabilité, des moyens. Trois éléments que l’AES ne maîtrise pas totalement.
La question est donc simple : le Sahel peut-il se permettre ce luxe, dans un moment où chaque dollar investi peut sauver des vies ou transformer des territoires ? L’Histoire tranchera. Mais une chose est sûre : dans cette équation, la marge d’erreur est infime, et les populations risquent de payer le prix d’un pari dont le rendement reste, pour l’heure, très hypothétique.





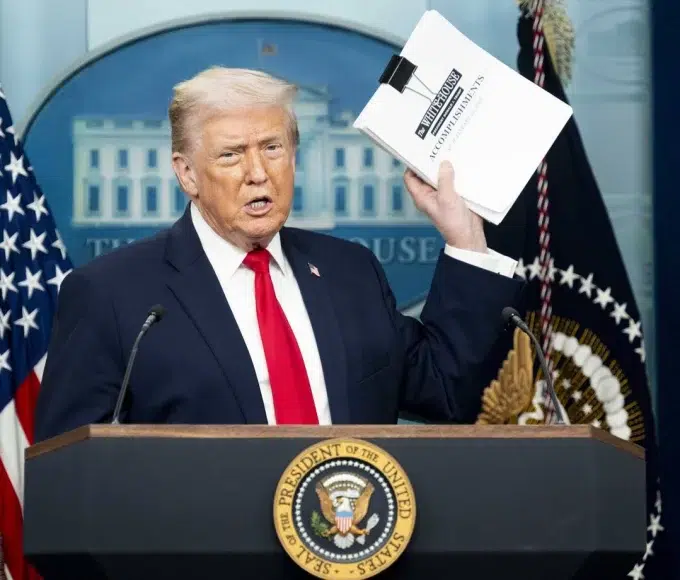











Leave a comment