Au-delà de sa nature militaire, la Zone AES (Mali, Burkina Faso, Niger) revendique un projet politique assumé : celui d’une rupture avec les institutions ouest-africaines et les modèles démocratiques traditionnels, au profit d’un discours de souveraineté nationale, d’ordre et de refondation de l’État. Mais ce projet politique repose-t-il sur une vision de long terme ou sur une logique de transition incertaine ?
Une gouvernance issue de transitions militaires
Les trois pays sont dirigés par des autorités militaires de transition. Au Mali, le colonel Assimi Goïta ; au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré ; au Niger, le général Abdourahamane Tiani. Tous sont arrivés au pouvoir à la suite de coups d’État, justifiés par l’incapacité des régimes civils à lutter contre le terrorisme et à répondre aux aspirations populaires.
La souveraineté, pilier central du discours
Le fil conducteur de la Zone AES est la reconquête de la souveraineté. Cela se traduit par :
Le rejet du franc CFA,
La dénonciation des accords de défense avec la France,
La volonté de contrôler les ressources minières et énergétiques,
La mise en avant d’un « patriotisme panafricain » centré sur les intérêts nationaux.
Ce discours trouve un écho favorable dans des populations fatiguées des promesses non tenues des démocraties électorales.
Des constitutions en réécriture
Les autorités de transition ont toutes entamé un processus de rédaction de nouvelles constitutions. L’enjeu est d’instituer une gouvernance forte, mais fondée sur des valeurs locales : souveraineté populaire, défense de l’unité nationale, rôle valorisé des forces armées, et contrôle renforcé de l’exécutif.
Un rejet des modèles importés
Le projet politique de l’AES se veut aussi une réponse à l’échec perçu du modèle démocratique libéral, accusé d’avoir favorisé la corruption, les élites déconnectées, et la dépendance envers les institutions internationales. La Zone AES cherche à imposer un modèle alternatif, plus proche des réalités sociopolitiques sahéliennes.
Une conception verticale du pouvoir
Dans les trois pays, le pouvoir est centralisé, incarné par un chef fort. La notion de transition ne rime pas (encore) avec ouverture politique : les oppositions sont peu audibles, les médias critiques parfois réprimés, et les processus électoraux repoussés. L’accent est mis sur l’ordre, la sécurité, et la reconstruction avant la démocratie.
Entre rupture radicale et pragmatisme
Si la rupture est nette sur le plan symbolique, les dirigeants de la Zone AES gardent une posture pragmatique : recherche de partenaires économiques, participation aux forums africains, et contacts indirects avec certaines chancelleries étrangères. Le projet politique AES reste donc évolutif, entre ambition souverainiste et nécessité de reconnaissance internationale.


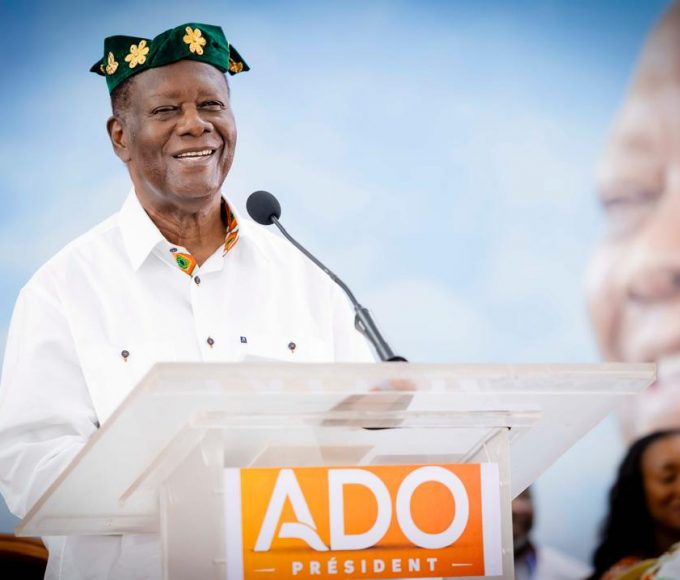














Leave a comment