Par La Rédaction
Le 15 octobre 1987, le capitaine Thomas Sankara tombait sous les balles de ses frères d’armes. Trente-huit ans plus tard, le Burkina Faso vit encore dans l’ombre de ce crime fondateur. L’émotion, la douleur, la quête de justice — tout cela est légitime. Mais à trop regarder vers le passé, le pays a cessé de marcher droit. Le Faso avance en boitant, les yeux rivés sur le fantôme de Sankara, sans regarder où poser le pied.
Depuis sa mort tragique, le Burkina Faso vit au rythme de la revanche et de la vengeance. À peine une blessure refermée qu’une autre s’ouvre. Le peuple burkinabè, pourtant digne et résilient, semble prisonnier d’un cycle d’obsession mémorielle où justice et rancune se confondent. Sankara, l’homme d’État, le visionnaire, n’a cessé d’être ressuscité — non pas pour prolonger son œuvre, mais pour alimenter les colères, justifier les exclusions, ou légitimer des dérives.
L’un de ses plus fidèles camarades, Boukary Kaboré dit « Le Lion », a crié vengeance jusqu’à son dernier souffle. Mais que reste-t-il de cet appel ? Une jeunesse passionnée mais désorientée, qui connaît Sankara à travers les slogans mais rarement à travers son programme. Une jeunesse qui l’élève en martyr sacré, mais peine à incarner sa pensée concrète. Une génération Traoré, du nom de l’actuel chef de la transition, qui tente de défendre l’Afrique… en reproduisant les mécanismes d’une époque révolue.
Une mémoire qui fige l’avenir
L’ironie est amère : le Burkina Faso, jadis chantre de l’autosuffisance alimentaire, est aujourd’hui importateur de riz. Là où Sankara exhortait les paysans à produire pour le Faso et pour eux-mêmes, l’État se bat pour subventionner les importations. Là où il construisait des écoles avec les communautés villageoises, on détruit les rares acquis éducatifs dans les conflits armés. Là où il dénonçait la dette comme un instrument de domination, on signe de nouveaux partenariats sans stratégie claire.
Il faut le dire sans détour : le peuple burkinabè doit faire le deuil de Sankara. Non pas pour l’oublier. Mais pour cesser de le brandir comme un talisman, un bouclier, ou une arme. Sankara n’est pas une incantation. C’est une pensée, un legs, un projet. Et il aurait sans doute honte de voir que ceux qui prétendent marcher dans ses pas n’ont souvent gardé de lui que les bottes, les slogans et les discours enflammés.
L’heure n’est plus aux kalachnikovs
Sankara, comme Lumumba, Cabral ou Nkrumah, utilisait les outils de son époque : la radio, le mégaphone, les rassemblements populaires, les discours frontaux, les alliances militaires. Mais nous sommes en 2025, dans la décennie de l’intelligence artificielle, de la blockchain, de l’écologie numérique et de la géostratégie des données. Peut-on prétendre incarner Sankara tout en continuant à gérer un pays avec des moyens du passé ? Peut-on défendre l’Afrique en récitant des discours révolutionnaires sans jamais bâtir d’institutions solides, sans industrialisation, sans éducation de masse, sans autonomie énergétique ?
Un Sankara contemporain n’aurait pas misé sur les armes. Il aurait formé des ingénieurs, des chercheurs, des professeurs, des diplomates stratèges. Il aurait plaidé pour l’indépendance alimentaire par l’agriculture de précision, pour l’indépendance politique par la souveraineté numérique, pour l’indépendance militaire par la capacité de défense technologique.
Le pardon, l’oubli et la construction
Accepter le pardon de Blaise Compaoré, c’est une décision politique, morale et personnelle. Mais tourner la page ne signifie pas effacer les crimes. Cela signifie comprendre qu’aucun pays ne se construit éternellement dans le ressentiment. L’Afrique, et le Burkina en particulier, a besoin de justice, oui, mais aussi de dépassement. Faire justice, ce n’est pas se venger. C’est empêcher que les fautes d’hier condamnent les enfants de demain.
Le « fourre-tout révolutionnaire » dans lequel s’engouffrent certains régimes sonne désormais comme une sanction divine : les discours enflamment les foules mais brûlent aussi les ponts vers le futur. L’Afrique n’a plus besoin de proclamations. Elle a besoin de méthodes. De structure. D’éducation. D’ordre stratégique. La révolution ne peut plus être une posture romantique : elle doit devenir une ingénierie de la souveraineté.
Conclusion
Thomas Sankara est mort debout. Il est temps que le Burkina Faso apprenne à marcher seul. Que la jeunesse cesse de l’idolâtrer pour commencer à le comprendre. Qu’elle transforme l’héritage en projet. Sankara nous a montré la voie, mais il ne faut pas confondre le chemin avec l’écho de ses pas.
Le Faso mérite mieux que la nostalgie. Il mérite un avenir.





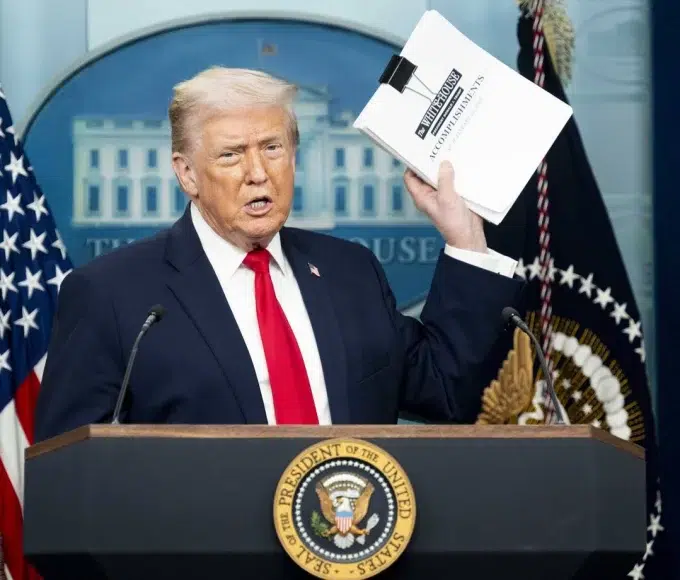











Leave a comment